L’(in)formation de ce qui (s’é)meut II : être-au-monde et savoir-vivre
- Humanimalab

- 19 févr. 2017
- 5 min de lecture
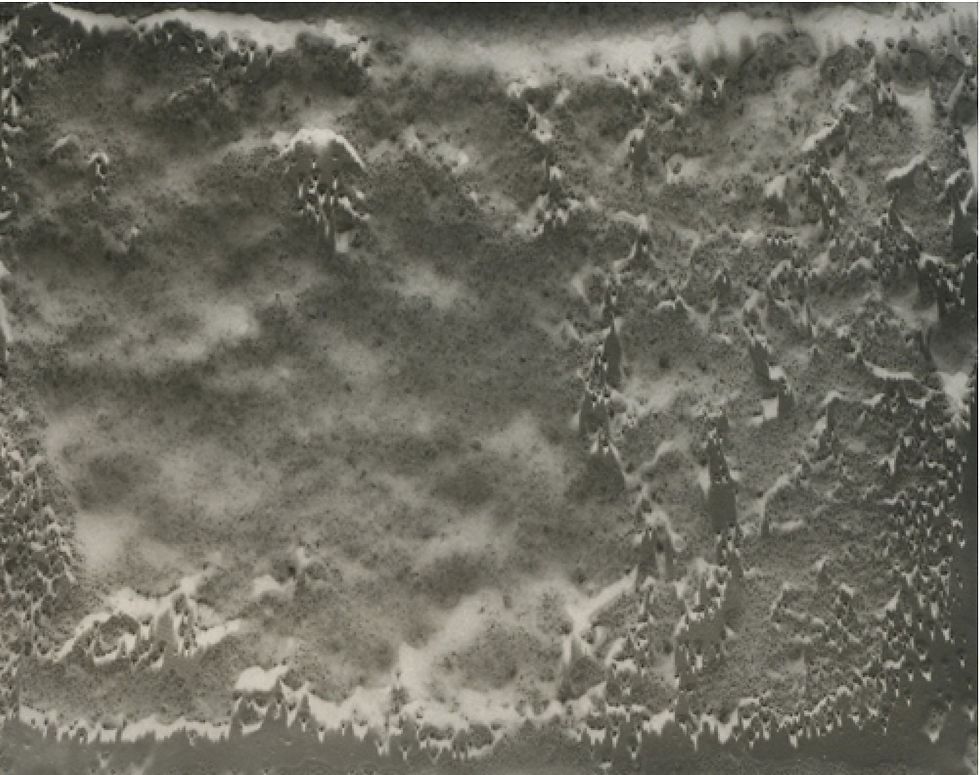
La pensée et la culture ont longtemps été considérées comme principales prémisses pour définir l’homme en contra-distinction avec l’animal. L’exploitation du nonhumain par l’humain est souvent justifiée par une supposée supériorité intellectuelle, par la capacité à ce que certains appellent la “culture” tandis que les animaux-nonhumains seraient issus de la “nature”.
Concernant la notion de supériorité intellectuelle, Morgan, dans Le castor américain, en fait un argument contre l’exploitation à outrance de l’animal, ou en tout cas du castor qu’il juge capable de théoriser son environnement, preuve qu’il n’est pas complètement dénué de toute intelligence (Morgan 2010, 262). Bien que Morgan dépasse les considérations seulement utilitaristes concernant la gestion des populations animales pour assurer la viabilité du commerce de peaux (Morgan 1868, 246), son argument maintient que l’intelligence reste la base pour justifier un rapport éthique envers des individus même non-humains. À ce sujet, Lestel rétorque que étant donné que nous traitons en tant que sujets donc, et non pas objets les individus autistes ou affectés de lésions cérébrales, en dépit même du fait qu’ils ne sont pas plus loquaces ni plus “penseurs” comme les humains dits “normaux”, la valeur d’un individu humain est vraisemblablement définie en fonction de sa ressemblance à d’autres humains, et non pas à ses capacités personnelles (2001, 327). Alors se pose la question, sur quoi devons-nous juger la valeur d’autres animaux non humains si “l’intelligence” et le langage articulé ne peuvent pas servir de prémisse à la définition de sujet? Par ailleurs, si la notion de sujet est relative à celle de culture, définie comme les pratiques sémiotiques donnant une signification à l’environnement (pratiques qui ne se limitent pas à la parole) alors les animaux non-humains peuvent être considérés comme sujets (Lestel 2001, 331). Ainsi, Lestel propose un déplacement épistémologique où l’humain ne serait pas le seul sujet à appréhender et à avoir prise sur le monde. Cette conception de la culture et du sujet viennent alors informer notre rapport éthique aux non-humains.
Bien qu’ici la catégorie “sujet” soit élargie pour inclure d’autres formes de vies nonhumaines, Lestel conserve la dichotomie objet-sujet. Et la notion de sujet étant relative à la notion d’agentivité, c’est à dire à la capacité à avoir prise sur le monde, à agir et réfléchir (faire sens) sur lui, alors selon cette conception, le non-animal serait passif et inerte. Et pourtant, le non-humain animal existe à travers le non-animal. Le non-animal nous affecte tout autant. Ces choses font de nous quelque chose d’autre, à la fois humain et non-humain. Une roche que l’on charge de signification, ou le principe actif d’une plante modifie nos trajectoires et nos modes d’individuation. Ils participent à la manière dont la vie s’organise. Alors, si le non-humain non-vivant a une signification en relation aux animaux qui vivent autour, s’il entre dans les pratiques sémiotiques du vivant, ne devrions-nous pas respecter le non-vivant pour ce qu’il signifie pour le monde animal humain et non-humain? Je pense ici par exemple à la destruction d’habitats, aux pratiques d’expropriation et d’exploitation de territoires habités. L’habitat est plus qu’un lieu de subsistence, il est un lieu de significations. La construction du “soi” est alimentée par la co-présence du vivant et du non-vivant. Plutôt que de parler d’agentivité pour penser la réflexivité de choses au monde, nous pourrions emprunter le terme de performativité pour penser la réalisation du “soi” du vivant avec le non-vivant comme processus d’actualisation d’un potentiel qui passe non seulement par la rencontre mais aussi par l’incorporation de la présence de l’autre et de sa signification. Ainsi, le sujet comme l’objet sont inlassablement constitués et reconstitués dans leur relation. L’un et l’autre n’existent que dans leur mise en rapport, dans la pratique et préhension de l’un sur l’autre. Si la distinction objet/sujet n’est plus si nette parce que l’a priori non-vivant, comme le vivant, font des choses et nous font faire des choses, alors devrions-nous nous montrer éthique à l’égard du végétal, du minéral, de la même manière qu’à l’égard du monde animal?
Penser le non-humain dans son couplage avec l’humain, implique que le non-humain n’est pas appréhendé par les services vitaux qu’il offre. Comme Levy-Bruhl disait des animauxqu’ils étaient bons à manger, la “nature” n’est pas seulement bonne à manger, ni ne sert de ressource conceptuelle pour réfléchir l’image de l’humain comme Lévi-Strauss le suggère avec la fameuse expression que les « animaux sont bons à penser » (1965). Il ne s’agit pas ici de se demander comment est-ce que la manière dont on se représente notre rapport au milieu vient informer notre manière d’être au monde comme Descola le suggère (2006), ni même à l’inverse de se demander comment une manière d’être au monde informe une manière de penser le monde (Ingold 2013, 304). Ces deux propositions posent la question d’une origine, et tentent de répondre à ce que l’on fait de ce monde. En revanche, je me demande ici ce que les choses font de nous, et comment nos gestes peuvent venir moduler la relation que l’on entretient avec le non- vivant.
Bateson proposait de reconsidérer notre approche au milieu en nous écartant d’une épistémologie moderne hubristique dite pathologique en ce qu’elle génère la destruction de l’environnement et l’extinction d’espèces. Bateson proposait notmment d’inverser le processus d’entropie systémique, et ainsi corriger la trajectoire d’un monde qui tend vers l’autodestruction. Mais la vie, la matière biologique, n’est pas optimale dans ses trajectoires, ni algorythmique. Elle peut être enregistrée pour être reproduite par un algorithme qui va retracer ses trajectoires a posteriori, mais elle ne peut pas être programmée a priori, car la contingence biologique est toujours indéterminée (Wilkins 2012). Ainsi une optimisation de notre rapport au monde, un point d’équilibre en terme de ressources disponibles, consommées et dissipées, est impossible car la vie se déploie dans la contingence d’autres présences. D’un point de vue éthique, cela serait d’ailleurs problématique de chercher un point d’équilibre. Cela impliquerait de nouvelles politiques cherchant à contrôler la vie, la normativiser par l’imposition d’un mode d’existence, appelant alors à un autre exterminisme (i.e. politique de l’enfant unique en Chine couplé à la technologie de l’échographie) (Esposito 2008, p6 ; Haraway 2010). Ainsi, si le processus d’entropie est irréversible, et que nous considérons l’épistémologie et ontologie sur un même plan d’immanence, alors peut-être qu’une partie de la solution ne serait pas d’intervenir à un niveau macropolitique mais à un niveau micro, par incrémentation de politiques locales que nous pourrions dire d’induction, qui invitent à reconsidérer ces gestes de consommation qui témoignent d’une relation au monde destructrice. La position éthique de l’approche cyclonopédique aurait pour but non pas d’échapper à la mort, ou la retarder par un “développement durable” qui consisterait en un management capitaliste des ressources, mais par une prise de responsabilités quant aux gestes que l’on pose. Ces gestes qui dans leur effectuation, nous l’avons vu, viennent réactualiser un mode de relation. De manière pragmatique, être responsable de nos gestes implique ce que Donna Haraway appelle littéralement une response- ability, une abilité à être attentif et conscient des présences qui nous entourent (Haraway, 2015). Au même titre, Ingold en appelle à un engagement ontologique, une éducation de l’attention, à une conscience de la portée de nos intentions (2013 pp.307-331). Il s’agit là d’une décision à prendre pour nous-même, à un niveau individuel et collectif, qui concerne qui est-ce que l’on veut être, sur quel mode voulons-nous mener nos vies. Cela nous mène à la notion d’intégrité, qui en latin signifie « l’état d’une chose qui est dans son sentier ». Une approche cyclonopédique est une invitation à incarner une posture épistémologique et ontologique conforme non pas aux chemins qui existent peut-être déjà, mais à dévier s’il le faut, pour vivre selon ce qui pour chacun d’entre nous fait éthiquement sens, au sens de signification, direction et sensation, pour vivre en accord avec soi-même.
Ainsi, nous pouvons ajouter à notre définition de la “réalité”, qui comprend ces non-humains non-vivant, que celle-ci est avant tout performative, éthiquement “enactée” et lieu de contingence. Qu’est ce que cela peut vouloir dire pour l’anthropologie? pour l’anthropologue dans sa relation au terrain? Et qu’est-ce que cela veut dire pour l’ethnographie?






Commentaires